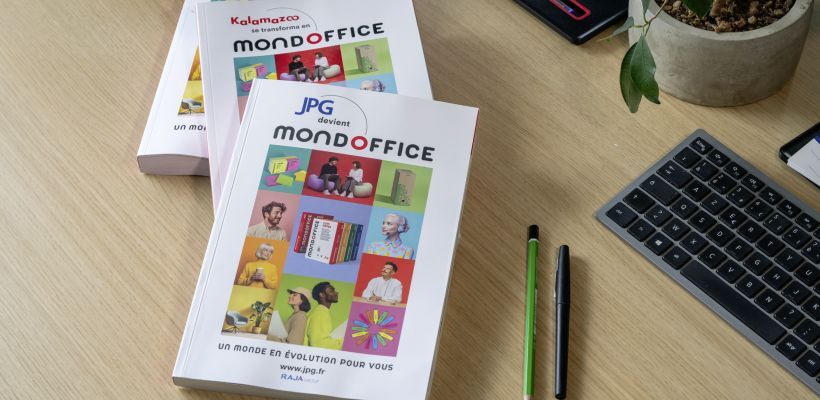Un espace WeWork à New-York, aux Etats-Unis
Un espace WeWork à New-York, aux Etats-Unis
Les pertes annuelles de WeWork ont doublé en 2018 pour atteindre le montant astronomique de près de 2 milliards de dollars (environ 1,7 milliards d’euros). La startup qui compte parmi les leaders de la mise à disposition de bureaux et de services de coworking a annoncé cette dégringolade lundi 25 mars, alors qu’en même temps son chiffre d’affaires a plus que doublé pour s’établir à 1,82 milliards de dollars. L’entreprise le reconnaît : ses lourdes dépenses engagées dans son développement à l’international sont responsables de cette situation. « Nous pouvons, si nous le voulons, modérer notre croissance et devenir rentable, a assuré le président de WeWork, Artie Minson, lors d’une interview au New York Times. Mais, pour le moment, nous voulons continuer à accélérer. »
Les doutes du premier investisseur
Ce n’est pas l’unique mauvaise nouvelle à laquelle doit faire face la société. Le taux d’occupation de ses locaux est en baisse, passant de 84% à 80% au quatrième trimestre 2018. Les revenus moyens générés par membre chaque année sont aussi plus faibles : ils ont subi une chute de 13,5% par rapport à 2016. Ces mauvais résultats sont d’autant plus préoccupants que leur annonce intervient après le refus du géant japonais Softbank – principal actionnaire de l’entreprise – d’engager 16 milliards de dollars. Le directeur du groupe, Masayoshi Son, a créé en partenariat avec l’Arabie Saoudite un fonds de placement de plus de 100 milliards de dollars, spécialisé dans la technologie. Il se serait confronté à la réticence des actionnaires émiriens et saoudiens. Ces derniers jugeaient cet engagement trop risqué, selon le Washington Post, et ont préféré injecter « seulement » 2 milliards de dollars. Un coup dur pour l’entreprise qui comptait sur cette somme pour poursuivre son développement.

Les rumeurs d’une « bulle high-tech », dont WeWork est un symbole fort, ont certainement contribué à ce refus de prise de risque de la part des investisseurs. Si la valorisation des startups technologiques explose, beaucoup ne font pas de bénéfice, voire accusent un déficit. C’est le cas du service de chauffeurs privés Uber, qui a perdu 1,8 milliards de dollars en 2018 mais aussi de son concurrent, Lyft, qui affiche une perte de 911 millions de dollars l’année dernière et n’a pas encore dégagé de bénéfice.
À la conquête de nouveaux marchés
Face à ces inquiétudes, Adam Neumann, l’un des cofondateurs de WeWork, assure que « leurs dépenses sont essentielles et qu’elles rapporteront beaucoup plus que ce qu’ils investissent ». La société a d’ailleurs un nouveau nom : « The We Compagnie », qu’elle a adopté début 2019, pour marquer sa volonté de se développer et englober les divers marchés qu’elle tente de conquérir. Celui du « co-living » avec WeLive, des espaces de coworking possédant des logements pour les entrepreneurs et WeGrow, comprenant une école primaire demandant un investissement de 36 000 à 42 000 dollars l’année ainsi qu’une académie de codage. D’autres innovations comme une banque en ligne sont aussi envisagés. Pour rassurer sur sa future rentabilité, la startup met en avant des grandes entreprises comme Amazon ou Airbnb, qui font partie de ses clients avec des contrats sur plusieurs années. Des propos à considérer avec un certain recul puisque « les responsables avaient déjà prédit il y a quelques années que la société serait désormais rentable », rappelle le Wall Street Journal. D’ailleurs, WeWork a confié en février au média TechChrunch qu’elle licenciait 3% de ses dix mille salariés. Il s’agirait, selon l’entreprise, du résultat « d’un processus standard d’évaluation annuelle de la performance. » Elle s’est donc séparée de trois cent collaborateurs des pôles ingénierie, conception de produit et expérience utilisateur. « Nous poursuivrons notre croissance et notre expansion en 2019, en embauchant 6 000 autres employés » a assuré a l’entreprise lors du même entretien.

Un modèle économique source d’interrogations
Fondée il y a dix ans, la jeune pousse a été valorisée à hauteur de 47 milliards de dollars en janvier 2019. C’est 21 fois plus qu’IWC, la maison mère de Regus, le premier fournisseur mondial d’espaces de travail flexibles. La startup a réussi à se faire une place en reprenant les codes de la Silicon Valley. Elle a également su profiter de la crise économique de 2007-2008 qui a libéré de nombreux locaux et a poussé les anciens salariés à devenir entrepreneurs ou free-lance. Mais l’effervescence des débuts est aujourd’hui largement retombée. Les plus sceptiques disent que le modèle peut facilement être copié, tandis que certains craignent que l’entreprise soit freinée par le ralentissement de l’économie et se retrouve coincée avec des loyers à honorer.