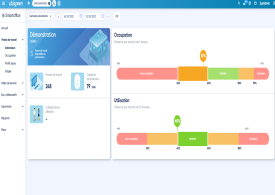Sixième mesure du plan mis en place par le gouvernement, le télétravail est envisagé comme un outil de sobriété à part entière, avec pour but premier de réduire l’utilisation de carburant. À première vue le calcul semble bon puisqu’environ 70 % des déplacements quotidiens effectués en voiture sont réalisés par les salariés se rendant sur leur...
Continuez votre lecture en créant votre compte et profitez de 5 articles gratuits
Pour lire tous les articles en illimité, abonnez-vous