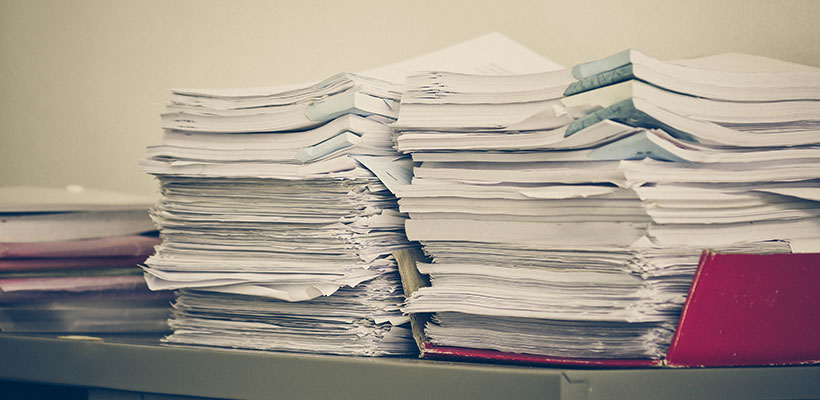Il reste le quotidien de millions de salariés. Ensuite, parce qu’il est toujours périlleux de juger l’esthétique des époques passées : ce qui nous semble terne ou daté fut souvent salué, en son temps, comme le nec plus ultra de la modernité.
Cela étant dit, difficile d’ignorer la tendance : les espaces de travail sont gagnés par un véritable mouvement d’esthétisation. Scénarisés, stylisés, ils deviennent des objets culturels à part entière, pensés pour séduire, raconter une histoire, offrir une expérience. Une mutation qui n’est d’ailleurs sans doute pas étrangère à ce phénomène plus large qui fait de la mise en beauté du quotidien une nouvelle norme sociale et culturelle.
Dans l’immobilier tertiaire, cette réaction « esthétisante » est aussi une réponse à plusieurs décennies de rationalisation à outrance. Réduit à un actif financier, le bureau a longtemps été envisagé comme un produit générique, sans qualités, conçu pour être aisément valorisable, revendable et louable. Une logique industrialiste qui arrive aujourd’hui en bout de course. L’essor du télétravail, l’attention portée au bien-être des collaborateurs comme la valorisation croissante des soft skills s’accommodent mal des plateaux uniformes et des néons blafards. Pour incarner l’identité d’une entreprise, séduire les talents, fidéliser les équipes, le bureau doit désormais « faire envie ».
On comprend aisément les vertus mais aussi les risques d’un tel mouvement. Car, au fond, derrière le sujet de l’esthétique se joue une autre question plus essentielle : pourquoi et comment donner aux collaborateurs de bonnes raisons de venir au bureau ? Y répondre suppose de déployer une nouvelle méthodologie pour penser les parcours utilisateurs et la relation entre les usages, le bâtiment et les services. C’est seulement au prix de cette ingénierie que la recherche de singularité ou même la beauté ne seront ni un simple décor ni un pastiche de la maison ou de l’hôtel mais bien une ressource au service du travail.